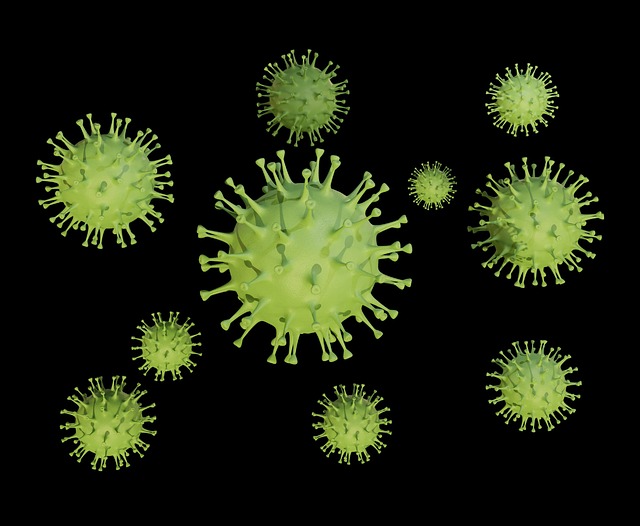Bien que le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) provoque une maladie respiratoire aiguë, de nombreux patients qui se sont rétablis du COVID-19 subissent par la suite une constellation de symptômes et d’événements hétérogènes tardifs durant plus de 3 mois après le début de la maladie. la maladie aiguë. infection.
Après un premier mouvement sur les réseaux sociaux déclenché par les patients, la communauté médico-scientifique a reconnu, dans le spectre des symptômes et des manifestations tardives, un lien possible avec le COVID-19. La condition a été nommée LONG-COVID ou POST-COVID. Ces termes ont été introduits pour fournir une nosologie commune adaptée au codage de tous les symptômes et preuves cliniques d’implication d’un organe/système.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu que « certaines personnes qui ont eu le COVID-19, qu’elles aient été hospitalisées ou non, continuent de ressentir des symptômes, tels que de la fatigue, des symptômes cardiovasculaires, respiratoires et neurologiques ». L’OMS a précisé l’utilisation du terme POST-COVID comme suit : « la nécessité de lever l’ambiguïté entre une maladie aiguë, des effets tardifs ou une évolution prolongée a conduit à la formulation neutre de Post-COVID ». La dernière mise à jour de l’OMS inclut désormais un nouveau code CIM pour les pathologies post-COVID-19 (condition spécifique UO9+).
Épidémiologie
Les premières études incluaient uniquement des patients hospitalisés pour une forme aiguë de COVID-19. Les pourcentages de COVID long chez les survivants variaient entre 30 % et 80 % ; les patients ont signalé au moins un symptôme persistant plusieurs mois après la résolution de la phase aiguë de la maladie. Cependant, la plupart des patients atteints du COVID-19 n’ont pas eu besoin d’être hospitalisés.
Par conséquent, une estimation globale ne peut dépendre que d’un suivi systématique des patients ayant été testés positifs au virus ou ayant démontré une sérologie positive. La prévalence attendue des symptômes post-COVID est d’environ un tiers de l’ensemble des cas de COVID-19 de la population. Le fardeau est tel qu’il a conduit à l’activation de cliniques ambulatoires Long-COVID dans tous les pays touchés par la pandémie.
Symptômes
Les manifestations cliniques hétérogènes comprennent à la fois des symptômes constitutionnels tels que la fatigue, des difficultés ou une perte d’attention et des troubles de la mémoire, ainsi que des symptômes et événements liés aux organes/systèmes impliquant les aspects immunologiques, respiratoires, cardiovasculaires, neurologiques centraux et périphériques, musculaires, hématologiques, gastro-intestinaux, rénaux. /systèmes urinaire, endocrinien et cardiométabolique.
Généralement, le diagnostic de syndrome COVID long ou post-COVID est posé en présence d’un ou plusieurs symptômes communément décrits par les patients comme une détérioration sans précédent de l’état psychophysique individuel. Dans ce contexte, l’atteinte cardiovasculaire nécessite l’identification de biomarqueurs mesurables ayant une spécificité diagnostique.
Symptômes durables
La COVID longue est diagnostiquée au moins 12 semaines après le début de la COVID-19.
Les symptômes peuvent représenter un continuum avec ceux de la phase aiguë, suggérant une persistance des symptômes ; Il n’a pas encore été établi s’il existe un long COVID « chronique ». Long COVID a un début mais pas de fin précise. Les études les plus récentes rapportent désormais des données de prévalence un an après le début de l’infection : « à 12 mois, seuls 22,9 % des patients sont totalement indemnes de symptômes ».
Maintenir un suivi est essentiel pour définir les délais et notamment la fin des symptômes. Les symptômes individuels peuvent durer pendant des intervalles de temps variables, certains régressant et d’autres persistant plus longtemps.
Par exemple, les symptômes neurocognitifs prolongés de la COVID-19 peuvent persister pendant au moins un an après l’apparition des symptômes de la COVID-19. La longue durée de récupération semble être liée à une gravité élevée, mais des hospitalisations et des admissions en unités de soins intensifs ont également été rapportées indépendamment de la gravité de la phase aiguë.
Qui développe un long COVID ?
La COVID longue semble être plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, mais cela pourrait refléter une plus grande gravité de la COVID-19 chez les hommes, qui ont présenté des taux d’hospitalisation et un risque de mortalité plus élevés. Par conséquent, les estimations relatives au Long COVID ne reflètent pas l’épidémiologie du COVID-19, mais uniquement celle relative aux survivants du COVID-19 et excluent le nombre élevé de patients décédés, principalement des hommes et des personnes âgées.
La répartition par âge dans Long COVID doit être lue du point de vue des survivants de la phase aiguë : cette condition est en effet répandue chez les personnes d’âge moyen. D’une part, le COVID-19 est moins fréquent chez les jeunes, d’autre part, de nombreuses personnes âgées sont décédées.
Deux groupes principaux peuvent être distingués : (i) les patients présentant des comorbidités préexistantes , cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinales, néphrologiques, endocriniennes, etc. (ii) les patients sans comorbidités connues avant le COVID 19.
L’analyse de la relation entre la phase aiguë, la nécessité d’une hospitalisation en unité de soins intensifs (USI), les services hors USI et l’absence d’hospitalisation, démontre qu’une longue COVID peut survenir indépendamment de la fragilité ou des morbidités préexistantes.
Atteinte cardiovasculaire : symptômes
Palpitations
Les patients potentiellement touchés par Long COVID se plaignent souvent de palpitations ; Elles peuvent correspondre à de simples tachycardies sinusales ou à des arythmies supraventriculaires ou ventriculaires. Ces manifestations n’ont pas de spécificité diagnostique, mais doivent être soigneusement étudiées car elles sont une cause fréquente de demandes d’assistance médicale. Cependant, les modifications électrocardiographiques de novo, absentes avant la COVID-19, et même absentes au moment de la guérison, sont rarement décrites. En fait, ces changements ne devraient être considérés comme de novo que lorsqu’un électrocardiogramme (ECG) pré-COVID de base est disponible.
Douleur préchoridale
La douleur thoracique est un autre symptôme dont se plaignent généralement les patients atteints de longue durée de COVID. Ces douleurs ne correspondent souvent pas à des constatations instrumentales utiles à une interprétation correcte.
Syndrome de tachycardie posturale
Lorsqu’une tachycardie orthostatique excessive et des symptômes d’intolérance orthostatique pendant au moins 3 mois font partie du syndrome de COVID longue, cela peut conduire à un diagnostic de syndrome de tachycardie posturale post-COVID-19 (POTS). Le diagnostic est posé devant une augmentation > 30 bpm chez l’adulte (> 40 bpm chez les patients âgés de 12 à 19 ans) dans les 10 minutes suivant la mise en position verticale en l’absence d’hypotension orthostatique associée à des symptômes d’intolérance orthostatique. Plusieurs rapports de cas ont récemment décrit des patients ayant développé un POTS après une infection par le SRAS-CoV-2.
Atteinte cardiovasculaire : résultats et événements
Insuffisance cardiaque
Bien que de nombreux articles de revue incluent l’insuffisance cardiaque (IC) parmi les manifestations cliniques possibles du syndrome de Long COVID, les études qui ont documenté la survenue d’une IC de novo chez des patients guéris de la COVID-19 sont rares. Dans la plupart des études, les données sur les patients présentant une IC préexistante pouvant s’aggraver après le COVID-19 sont rapportées ainsi que les quelques cas d’IC de novo. Cela limite la capacité d’identifier les cas dans lesquels l’IC est en fait une manifestation clinique d’un long COVID.
Manifestations thrombotiques veineuses
Les événements thromboemboliques enregistrés dans les cas de COVID long au cours de la première année suivant la guérison d’une forme aiguë de COVID-19 comprennent la thrombose veineuse profonde (2,4 %) et la thromboembolie pulmonaire (1,7 %). Une stratégie de suivi a été proposée pour évaluer le fardeau du risque résiduel, des lésions des petits vaisseaux et des séquelles hémodynamiques potentielles en observant l’état de perfusion pulmonaire.
thrombose artérielle
La thrombose artérielle chez des sujets sans pathologie vasculaire connue est souvent décrite comme occasionnelle dans des rapports de cas ou de petites séries cliniques. Outre les artères coronaires, avec des manifestations de syndromes coronariens aigus chez des sujets à faible risque et sans coronaropathie significative à l’angiographie, des épisodes thrombotiques/thromboemboliques inexpliqués continuent d’être décrits au niveau périphérique/cérébral/splanchnique. La gravité de l’infection aiguë, la nécessité d’une hospitalisation en réanimation ou hors réanimation, ainsi que la prise en charge des infections en milieu non hospitalisé, ne sont pas en corrélation avec ces thromboses de novo.
Arythmies de novo
Bien qu’il soit difficile d’établir l’heure d’apparition des épisodes arythmiques, des arythmies supraventriculaires et ventriculaires ainsi que des troubles de la conduction ont été rapportés parmi les manifestations possibles du COVID long.
Myocardite, péricardite, myopéricardite
La myocardite est un sujet débattu à la fois dans le cas du COVID-19 et du COVID long, principalement en raison d’un diagnostic incomplet et donc d’un manque de certitude, en particulier de preuves pathologiques. Dans plusieurs études, le diagnostic de myocardite repose sur les niveaux d’ hypertroponinémie isolée ou sur la combinaison d’hypertroponinémie et de signes d’œdème myocardique sur CMR. Il serait correct de décrire une hypertroponinémie et/ou un œdème persistants, sans forcer son interprétation à une myocardite.
Conditions cardiométaboliques
Le diabète, de type 1 et de type 2, est associé au COVID-19 sévère et au COVID long. Les interventions visant à cibler plusieurs facteurs de risque, combinées à l’utilisation de nouveaux agents hypoglycémiants qui améliorent la fonction métabolique et les processus clés affectés par la COVID-19, devraient être les options thérapeutiques privilégiées pour le traitement des personnes atteintes de la COVID. traîné.
Marqueurs et résultats mesurables
Le diagnostic de COVID long nécessite un changement de paradigme dans l’aptitude du clinicien à accepter uniquement des rapports descriptifs pour le diagnostic ; Les données épidémiologiques cliniques, basées en grande partie sur le récit des symptômes, montrent des pourcentages si élevés que la maladie est perçue comme une véritable « pathologie », à laquelle l’OMS a attribué une reconnaissance formelle dans le code CIM10 UO9. Cependant, ce code est rarement utilisé en pratique clinique, ce qui limite son rôle potentiel dans les études épidémiologiques. De plus, de nombreux pays adoptent encore le système CIM-9. Deux apports diagnostiques importants doivent être soulignés : les biomarqueurs et les preuves instrumentales et d’imagerie, particulièrement utiles s’il est possible de démontrer leur absence dans la phase pré-COVID.
Les biomarqueurs les plus fréquemment testés sont ceux liés à (i) l’inflammation systémique, comme la protéine C-réactive, les neutrophiles, les lymphocytes et les plaquettes ; (ii) l’activation immunitaire telle que le dosage de cytokines [généralement l’interleukine (IL) 6] ; (iii) des marqueurs d’hypercoagulabilité , tels que les niveaux de fibrinogène, de D-dimères ou des tests fonctionnels d’hyperactivité plaquettaire ; (iv) des dommages aux myocytes , tels que les taux plasmatiques de troponine I de haute sensibilité ; (v) stress/charge myocardique tel que les peptides natriurétiques. Moins fréquent est le dosage des alarmines (HMGB1 ; HSP ; IL-1α ; IL-33 ; LL-37 ; S100 ; défensines), étudiées aussi bien en phase aiguë que dans le COVID long. vingt
La preuve instrumentale de dommages persistants et non préexistants est difficile à démontrer car elle doit se baser sur l’absence de résultat dans la phase pré-COVID. Cependant, les études d’imagerie, notamment l’IRM cardiaque , se multiplient et fournissent des informations insuffisantes pour attribuer avec certitude les résultats au COVID long. Entre les groupes séropositifs et séronégatifs, il peut n’y avoir aucune différence dans la structure cardiaque (volumes ventriculaires gauches, masse, zone auriculaire), la fonction (fraction d’éjection, raccourcissement longitudinal global, distensibilité aortique), la caractérisation des tissus (T1, T2, fraction volumique extracellulaire, tardive). rehaussement de gadolinium).
Hypothèses pathogénétiques
La pathogenèse du Long COVID est inconnue. La grande hétérogénéité des symptômes suggère qu’il s’agit d’un trouble multisystémique. L’hypothèse d’un rôle direct du virus et de sa possible persistance doit être soigneusement étudiée, notamment parce qu’il n’existe aucune preuve directe d’une persistance virale dotée de propriétés de réplication. Au contraire, il est possible que des fragments du génome viral ou des antigènes viraux, sans capacité infectieuse, persistent dans le temps.
Une étude très récente rapporte la possibilité que le génome viral soit rétro-transcrit et intégré à l’ADN, devenant ainsi moteur et source de synthèse d’ARN et d’antigènes d’origine virale. D’une part, les auteurs suggèrent de manière plausible que ce phénomène est à l’origine des tests positifs persistants chez les patients guéris du COVID-19 22 ; D’un autre côté, ces molécules peuvent maintenir active la cascade immuno-inflammatoire-procoagulante, expliquant potentiellement, par exemple, des événements thrombotiques tardifs.
L’hypothèse immunologique/à médiation immunitaire pourrait également être liée à cette possibilité. Cette hypothèse est soutenue à la fois par les mécanismes pathogéniques du COVID-19, avec la tempête de cytokines induite par la réaction inflammatoire-immunitaire à l’infection, et par les premières études qui ont rapporté une augmentation des auto-anticorps, par exemple des élévations des titres d’ANA. , 9 qui n’ont cependant pas de spécificité diagnostique.
Un front de recherche commun suivi par plusieurs équipes explore la persistance à la fois du génome/peptides viraux et de l’inflammation, évaluant la possibilité que, parmi les facteurs immunomodulateurs/cytokines, des substances ayant des effets neuromodulateurs puissent être à la base de symptômes neurologiques courants chez ces patients. Cependant, l’hétérogénéité des symptômes, notamment les difficultés de santé mentale, l’anxiété, les crises de panique et les troubles cognitifs et mnésiques, devraient laisser ouverte la possibilité de poursuivre d’autres objectifs de recherche que les plus plausibles.
Traitement
Le traitement des patients dont le diagnostic repose uniquement sur les symptômes reflète l’absence de marqueurs mesurables de la maladie, ce qui rend le traitement empirique et orienté dans le seul but de contrôler les symptômes subjectifs.
Bien que des tests biochimiques ou des évaluations instrumentales non invasives soient effectués régulièrement, les biomarqueurs ou les données instrumentales peuvent ne pas apporter de contribution diagnostique démontrant des lésions organiques ou tissulaires. Vice versa, lorsque les symptômes sont associés à des signes de lésions organiques [augmentation des niveaux de biomarqueurs (par exemple, lésions des myocytes) ou modifications de l’ECG, résultats d’imagerie ou événements aigus], les traitements sont guidés par les phénotypes. clinique.
Impact
L’impact global du Long COVID ne peut être ignoré : il fait référence aux performances psychophysiques individuelles, aux sphères sociale, productive et économique dans le contexte médical, financier et professionnel. La perte d’efficacité au travail, le besoin de soutien médical, l’exigence de diagnostic rendent cette condition digne d’une nouvelle vision des investissements dans le secteur de la santé, visant également à contenir les conséquences sociales de l’épidémie et à gérer la santé au travail. .
En effet, la pandémie de SRAS-CoV-2 a détourné l’attention du retour au travail après des problèmes de santé vers la reprise du travail pendant une épidémie, la gestion du confinement et la prise en compte particulière des travailleurs vulnérables.
Conclusions Le Long COVID est une entité pas encore entièrement comprise comprenant une constellation de symptômes hétérogènes d’étiologie incertaine et de causalité directe incertaine de l’infection par le SRAS-CoV-2. La majeure partie de cette incertitude est imputable aux données largement rétrospectives publiées à ce jour. La collecte systématique et prospective de données de suivi clinique, facilitée par l’ouverture de cliniques ambulatoires post-COVID, ainsi qu’une comparaison précise des caractéristiques cliniques des patients avant et après le SRAS-CoV-2, peuvent contribuer à corroborer leur cohérence. . De plus, pour atteindre l’objectif thérapeutique, de nombreuses questions sur les mécanismes pathogènes du SRAS-CoV-2 restent sans réponse. |